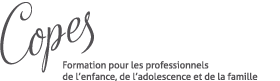Formes et effets du transfert négatif dans les cures d'adolescents et de jeunes adultes
2e journée scientifique organisée par le Centre de Psychanalyse Henri Danon Boileau - 2 Avril - Sceaux
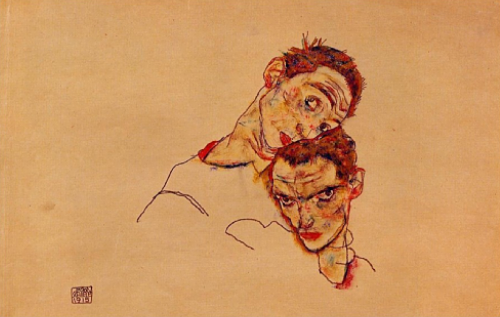 « Le phénomène étrange » que constitue le transfert ne paraît jamais tant exacerbé que dans les situations de crise susceptibles de survenir, inévitablement, au cours d’un traitement psychique. Qu’il s’agisse de la répétition d’expériences sensibles, d’émergences symptomatiques graves, d’évènements traumatiques ou encore de moments d’égarement douloureux, ces passages bouleversent, décontenancent voire désorganisent la vie psychique. Si le transfert désigne le processus par lequel les désirs inconscients s’actualisent sur certains objets, en l’occurrence l’analyste dans le cadre de la cure, s’il provoque, par voie de déplacement, la répétition de «prototypes » des relations infantiles c’est d’abord l’ambivalence pulsionnelle qui le caractérise : très tôt, Freud distingue deux transferts, l’un positif, l’autre négatif, un transfert de sentiments tendres et un transfert de sentiments hostiles. Le transfert négatif est donc partie prenante de tout traitement psychique, il est une composante inéluctable du processus parce qu’il est créé et animé par les pulsions et leur nécessaire antagonisme. Quelles que soient les théories pulsionnelles qui en organisent l’élaboration, la sexualité infantile et la conflictualité occupent une place et fonction fondamentales surtout dans leur prise avec l’amour et la haine, surtout dans les articulations qu’elles produisent, entre perte et castration, entre passion et détresse :les choix d’objet et les identifications constituent la substance même du transfert et leurs nécessaires oppositions, leurs contradictions répétitives se nourrissent de l’ambivalence. Sans compter sa contribution essentielle et décisive dans l’action du surmoi. Cependant, une fois établies les définitions de base qui tentent de le contenir et de l’apprivoiser, le transfert négatif ne se laisse ni approcher ni saisir aisément surtout lorsque l’amplitude pulsionnelle s’y révèle avec une force inattendue : on accepte et on supporte les excès de l’amour de transfert, mais sa forme négative, hostile, haineuse, suscite chez le patient comme chez l’analyste de puissantes résistances. A cet égard, les cures d’adolescents et de jeunes adultes apparaissent paradigmatiques : la violence de l’atteinte narcissique et le débordement des frontières mettent à nu la fragilité du moi et la difficile contenance de pulsions qui s’emballent, en quête de représentations perdues faute de s’attacher plus solidement à la scène du fantasme. La projection y occupe une place massive, parfois intraitable tant l’aveuglement qu’elle entraîne semble assurer une fonction vitale. L’actualisation oedipienne dans ses configurations les plus brutales, lorsque l’inceste et le meurtre affleurent du fait d’un refoulement affaibli par l’état de crise, envahit le champ de l’analyse par la domination de la compulsion de répétition au détriment de la remémoration. Celle-ci est trop chargée par la douleur de la perte et par la nécessité de renoncer aux objets d’amour originaires, lestée par le poids d’une nostalgie insupportable et menaçante et par l’idéalisation manifeste ou sous-jacente de l’analyste. C’est la destructivité qui s’aggrave alors dans et grâce au transfert, une destructivité en quête de formes et de contours, mais qui n’en est pas moins emportée par la masse d’investissements négatifs, cachant voire occultant les stigmates de la frustration, de l’abandon et de la persécution. Cette destructivité ne s’énonce pas seulement avec des mots, elle s’incarne et se met en actes par l’inflation symptômatique, par l’attaque du cadre ou par le retournement sur la personne propre dans un acharnement auto-destructeur inquiétant.
« Le phénomène étrange » que constitue le transfert ne paraît jamais tant exacerbé que dans les situations de crise susceptibles de survenir, inévitablement, au cours d’un traitement psychique. Qu’il s’agisse de la répétition d’expériences sensibles, d’émergences symptomatiques graves, d’évènements traumatiques ou encore de moments d’égarement douloureux, ces passages bouleversent, décontenancent voire désorganisent la vie psychique. Si le transfert désigne le processus par lequel les désirs inconscients s’actualisent sur certains objets, en l’occurrence l’analyste dans le cadre de la cure, s’il provoque, par voie de déplacement, la répétition de «prototypes » des relations infantiles c’est d’abord l’ambivalence pulsionnelle qui le caractérise : très tôt, Freud distingue deux transferts, l’un positif, l’autre négatif, un transfert de sentiments tendres et un transfert de sentiments hostiles. Le transfert négatif est donc partie prenante de tout traitement psychique, il est une composante inéluctable du processus parce qu’il est créé et animé par les pulsions et leur nécessaire antagonisme. Quelles que soient les théories pulsionnelles qui en organisent l’élaboration, la sexualité infantile et la conflictualité occupent une place et fonction fondamentales surtout dans leur prise avec l’amour et la haine, surtout dans les articulations qu’elles produisent, entre perte et castration, entre passion et détresse :les choix d’objet et les identifications constituent la substance même du transfert et leurs nécessaires oppositions, leurs contradictions répétitives se nourrissent de l’ambivalence. Sans compter sa contribution essentielle et décisive dans l’action du surmoi. Cependant, une fois établies les définitions de base qui tentent de le contenir et de l’apprivoiser, le transfert négatif ne se laisse ni approcher ni saisir aisément surtout lorsque l’amplitude pulsionnelle s’y révèle avec une force inattendue : on accepte et on supporte les excès de l’amour de transfert, mais sa forme négative, hostile, haineuse, suscite chez le patient comme chez l’analyste de puissantes résistances. A cet égard, les cures d’adolescents et de jeunes adultes apparaissent paradigmatiques : la violence de l’atteinte narcissique et le débordement des frontières mettent à nu la fragilité du moi et la difficile contenance de pulsions qui s’emballent, en quête de représentations perdues faute de s’attacher plus solidement à la scène du fantasme. La projection y occupe une place massive, parfois intraitable tant l’aveuglement qu’elle entraîne semble assurer une fonction vitale. L’actualisation oedipienne dans ses configurations les plus brutales, lorsque l’inceste et le meurtre affleurent du fait d’un refoulement affaibli par l’état de crise, envahit le champ de l’analyse par la domination de la compulsion de répétition au détriment de la remémoration. Celle-ci est trop chargée par la douleur de la perte et par la nécessité de renoncer aux objets d’amour originaires, lestée par le poids d’une nostalgie insupportable et menaçante et par l’idéalisation manifeste ou sous-jacente de l’analyste. C’est la destructivité qui s’aggrave alors dans et grâce au transfert, une destructivité en quête de formes et de contours, mais qui n’en est pas moins emportée par la masse d’investissements négatifs, cachant voire occultant les stigmates de la frustration, de l’abandon et de la persécution. Cette destructivité ne s’énonce pas seulement avec des mots, elle s’incarne et se met en actes par l’inflation symptômatique, par l’attaque du cadre ou par le retournement sur la personne propre dans un acharnement auto-destructeur inquiétant.
En de telles situations, de quels moyens dispose l’analyste pour traiter le transfert négatif ? Faut-il le considérer comme une résistance et donc comme un moteur de l’analyste ? Est-il possible de l’interpréter ? Les constructions sont-elles davantage susceptibles de lui offrir de potentielles représentations ? Suffit-il de l’entendre ou de le circonvenir ? Faut-il très vite l’associer au courant libidinal avec l’espoir de lier les pulsions agressives en luttant contre la désintrication ?
Ce sont ces questions, et d’autres encore, que le Colloque organisé par la Centre de Psychanalyse de la Clinique Dupré propose de mettre au travail : quelles qu’en soient les formes, le transfert négatif est le transfert et ne saurait être ni éludé, ni négligé ni annulé dans le processus analytique. Il porte cette composante essentielle de la psyché que représente l’ambivalence : son émergence, son déploiement, les modalités de son traitement assurent la vitalité de la psychanalyse en préservant les conditions de sa méthode.
Samedi 2 avril 2016
Théâtre Les Gémeaux
49 avenue Georges Clémenceau
92330 Sceaux
10€-20€-30€ places limitées