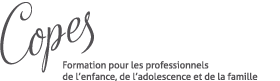Clara Nezick, Loin des yeux… Émotions confinées de l’Usis
Hors temps de pandémie, à l’USIS (Unité de Soins Intensifs du Soir) nous accueillons dans nos locaux des enfants dont l’organisation pathologique se déploie dans des troubles du comportement qui les rendent difficilement supportables pour ceux qui s’occupent d’eux (famille et professionnels). Ces enfants, présentant ce que Roger Misès qualifiait de « pathologies limites », bougent sans cesse, crient, insultent, frappent, détruisent, et malgré une intelligence la plupart du temps préservée, ils n’apprennent pas ou très mal à l’école.
Ils ont connu au cours de leur développement précoce (et moins précoce) une défaillance de l’environnement, c’est-à-dire qu’ils sont, à un ou plusieurs moments, « tombés » de la tête de leurs parents. Du fait de ce vécu, une forte angoisse d’abandon les agit (les agite) et les coince dans un paradoxe sans fin : ils veulent fortement être en lien, mais ne peuvent qu’attaquer ce dernier quand il commence à se tisser par crainte de l’abandon qui pourrait en découler.
Le constat à l’origine de la création de cette USIS, par Michel Soulé en 1981, était que ces enfants dont le mal-être et la détresse s’expriment à travers des symptômes bruyants, ne pouvaient pas, ou difficilement, avoir accès aux différentes formes de thérapies individuelles proposées classiquement dans les centres de consultations. La prise en charge que nous leur proposons est de ce fait principalement groupale, sur le modèle de la psychothérapie institutionnelle.
Et dans ce cadre nous, soignants co-animant ces groupes thérapeutiques à médiations, directement exposés à leur pathologie du lien (puisque leurs difficultés se situent directement dans la relation à l’autre, qu’ils recherchent très fort tout en s’acharnant à la détruire en permanence), nous sommes amenés à ressentir des émotions parfois étonnantes, souvent très fortes, voire « submergeantes », qui ne peuvent clairement pas s’expliquer par notre seul tempérament, ou l’actualité de notre vie quotidienne personnelle.
Pourquoi je sors épuisée, vidée, plombée même, de ce groupe thérapeutique qu’un observateur extérieur aurait pourtant pu qualifier de « calme » ? Pourquoi je trouve si attachant et suis heureuse de retrouver cet enfant qui pourtant m’a frappée à plusieurs reprises, et ne peut m’adresser d’autres mots que des injures ; alors que cet autre enfant qui respecte les règles de politesse m’agace au plus haut point ? Pourquoi lorsque je m’installe dans une activité avec ce jeune, je me retrouve à ne plus pouvoir penser, créer, associer, dans un véritable état de sidération ?
Freud, avec la notion de contre-transfert, est le premier à conceptualiser l’implication émotionnelle des soignants. Cette notion, à l’origine utilisée par les psychanalystes, a depuis été largement élargie à tous ceux qui soignent, aident, accompagnent.
Et bien que je rencontre encore des professionnels (travailleurs sociaux, assistants familiaux, auxiliaires de puériculture, etc.) qui ne sont pas du tout sensibilisés à cette question, et qui peuvent même encore s’entendre dire « il ne faut pas s’attacher ! », « il faut laisser ses émotions au vestiaire ! », et qui de ce fait ne peuvent évoquer leurs ressentis professionnels qu’avec honte et culpabilité, bien que malheureusement cela perdure encore, nous savons que toute relation d’aide, quels que soient les pratiques et les supports sur lesquels elles s’appuient, active les processus émotionnels.
Oui, travailler dans la relation à l’autre génère des émotions ! Et non seulement cela est normal, mais c’est en plus très utile.
Utile parce que nos ressentis en tant que professionnels, et les émotions qui en sont sous-jacentes, nous permettent d’appréhender de l’intérieur ce que vit l’autre et nous renseignent sur sa détresse. Ils sont un véritable outil sémiologique.
Mais la valeur sémiologique de ces mouvements émotionnels n’apparaît pas d’emblée. Ils peuvent d’abord provoquer de la gêne, de l’inconfort, voire même entraîner une totale sidération de la pensée et entraver de ce fait nos compétences professionnelle.
Face aux provocations répétées de cet enfant, je sens monter en moi une colère, mais une intense, qui me chauffe le visage et fait que je n’ai plus qu’une chose en tête, c’est que je veux lui « en coller une », la seule solution sur le moment étant de m’éloigner pour un temps cette relation. Être submergée par cette émotion est un clignotant qui m’alerte qu’il faut entrer dans d’autres modalités de travail. Et pour sortir de ce qui peut s’associer à cette émotion (la gêne et la culpabilité de n’avoir pas su mieux gérer la situation, le jugement d’avoir été incompétente, …) ; pour pouvoir la relier à ce que cela nous apprend sur le fonctionnement de cet enfant, en l’éclairant de ce que nous connaissons de son histoire pour, à terme, pouvoir l’accompagner au mieux, il faut pouvoir reprendre de la distance.
Et cette prise de distance vis-à-vis des mouvements émotionnels ne peut se faire seul. Bien sûr, l’expérience aide beaucoup, car savoir à priori, avant même d’en saisir la signification, que ce que nous éprouvons a une valeur sémiologique, peut diminuer notre vécu de déstabilisation et d’impuissance. Mais il faut un collègue, une équipe, un cadre institutionnel, pour pouvoir partager et élaborer autour de ces émotions.
En résumé les émotions, et les ressentis qui y sont liés, naissant dans les relations d’aide quelles qu’elles soient, sont un véritable outil de soin en ce qu’elles nous éclairent sur le fonctionnement de l’autre et nous donnent des pistes de travail auprès de lui.
Cela nécessite qu’il soit possible d’identifier ces émotions ; que le cadre institutionnel permette de les exprimer et de les partager ; et que dans et avec ce cadre ait lieu une élaboration leur donnant sens, afin d’éclairer les processus psychopathologiques à l’œuvre.
Dans une structure telle que l’USIS, où nous prenons en charge des enfants souffrant de pathologies du lien aux symptômes bruyants et attaquants, travailler à partir et avec nos émotions est central. Et dans cette pratique au quotidien je ressens des « choses » fortes qui demandent à être transformées, que je n’hésite pas à partager en réunions d’équipe (ou entre deux portes) en me « lâchant », afin de m’en dégager, tout en écoutant sans jugement les collègues quand à leur tour ils partagent ce matériel brut en « vidant leur sac », tout cela en ayant très souvent recours à l’humour ; et en profitant ensuite de l’élaboration commune pour donner sens à ce qui s’est passé, et permettre de continuer ou relancer le travail thérapeutique avec ces jeunes pas toujours faciles.
Alors quand soudainement nous nous retrouvons confinés et que nous devons repenser complètement la forme de notre suivi auprès de ces enfants et de leurs familles, qu’en est-il de cet outil que sont les émotions ?
A l’USIS nous avons eu le temps, même s’il était très court, de préparer la fermeture, mais c’est une fois confinés chacun chez soi que nous avons pu penser aux modalités de suivi, n’ayant que notre téléphone pour être en contact avec les familles. Nos ambitions actuelles ne sont pas, par la force des choses, qualifiées de « cliniques » ou de « thérapeutiques », vocabulaire remplacé par celui de « maintien du lien », et d’« évaluation des situations ». Et depuis plusieurs semaines, avec mon « binôme de référence », nous téléphonons régulièrement, fréquemment, voire très souvent à sept enfants et familles, la fréquence variant selon les demandes, les besoins, mais aussi nos inquiétudes.
Cette communication apparaît selon les moments intrusive (car nous arrivons directement chez eux, et les amenons directement chez nous), non adaptée (avec des enfants qui ne sont pas en capacité d’exprimer leurs difficultés et leur souffrance par la parole, d’où la prise en charge en groupes avec médiations), mais surtout elle est frustrante.
Frustrante car elle nous prive d’une certaine spontanéité, et elle nous prive de toute la dimension sensorielle, non verbale, de la relation ; dimension sur laquelle s’appuie beaucoup le processus émotionnel évoqué plus tôt, qui nourrit la relation et lui permet d’évoluer.
Je ne peux pas dire que je sois en panne d’émotions dans mon travail, j’en ressens beaucoup, mais elles trouvent plus leur origine dans la situation qui nous est imposée actuellement que dans la relation-même aux enfants. Mais aussi frustrant et déstabilisant que cela soit, ce n’est peut-être pas plus mal. Je dis cela car j’ai vécu une exception avec ce jeune qui, au cours d’un appel plutôt court, où il n’a dit que quelques mots en réponse aux questions que je posais pour essayer de nourrir l’échange, m’a « contaminée » par sa dépression. Peut-être que cela a été possible car nous travaillons ensemble depuis plus de dix ans maintenant et que nous nous connaissons bien. Mais après avoir raccroché j’étais triste, « plombée », tout en sachant que ces ressentis étaient directement liés à mon échange avec lui. Et là, ce qui m’a manqué, ce sont les collègues, l’équipe, les échanges même informels qui auraient permis non seulement de m’aider à me dégager de ces affects dépressifs, mais surtout d’en faire quelque chose au service de ce jeune.
Car si les forums de discussion par messagerie et les réunions en « visio » sont très utiles pour échanger des informations, ils ne permettent malheureusement que difficilement le partage de vécus plus émotionnels et l’élaboration clinique.
Pour conclure, je dirais que cette expérience forcée de confinement nous prive de la clinique telle que nous la connaissons, avec ses méthodes et ses outils, mais que par ce manque, et en nous sortant de nos habitudes et de nos repères, elle nous oblige à les repenser, à créer, à imaginer, y compris pour l’après.
Le confinement n’aura pas non plus empêché certains rares « moments de grâce », quand par exemple cet enfant arrive à s’isoler avec le téléphone maternel, dans un logement que nous savons pourtant exigu, qu’il est très désireux d’échanger sur ce qui le préoccupe actuellement, et que nous nous retrouvons à « papoter » un certain temps, partageant un moment certes très factuel et peu engageant émotionnellement, mais somme toute très agréable et venant nourrir la relation pourtant mise à mal actuellement.
Pour autant, il est temps que cela s’arrête, et vivement la suite !
Clara Nezick
Psychologue clinicienne à l'Usis (Unité de Soins Intensifs du Soir)
Chargée de mission au Copes
Association Cerep-Phymentin